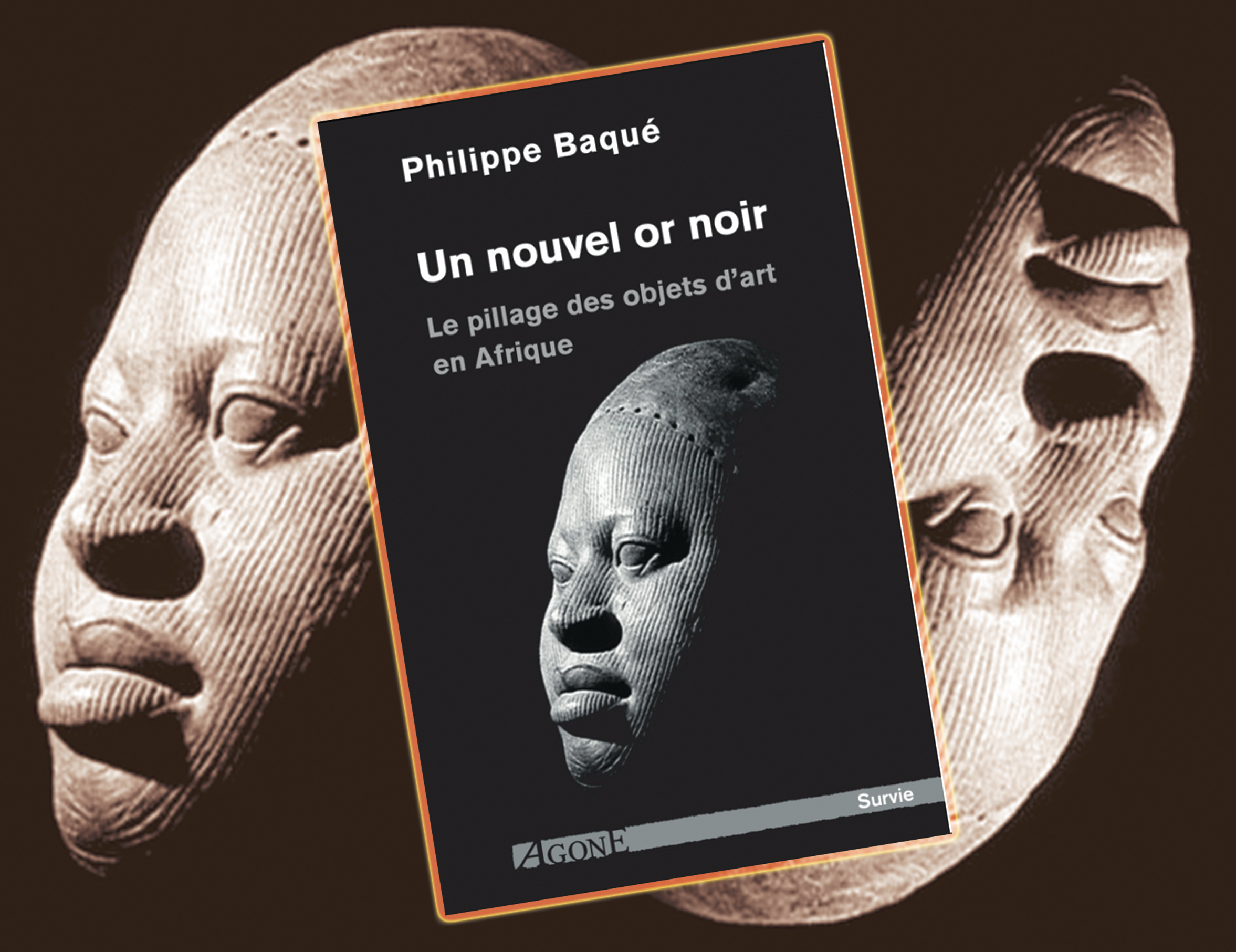
Ce livre est une « nouvelle édition revue et augmentée » d’un volume paru en 1999, à l’époque où se préparaient, sur l’initiative de Jacques Chirac et de son conseiller le marchand d’art Jacques Kerchache, l’ouverture au Louvre d’un Pavillon des Sessions dévolu aux « arts premiers » et la désignation d’une « mission de préfiguration » du futur musée du quai Branly (inauguré en 2006 et rebaptisé « Jacques Chirac » en 2016). Il était assez clair alors que ces institutions devaient servir de cache-sexe culturel et « moral » à l’ensemble des opérations plus ou moins inavouables qui perpétuaient le mode d’exploitation néocolonial connu sous le nom de « Françafrique ». Si celui-ci paraît aujourd’hui moins solide, battu en brèche là-bas par plusieurs gouvernements africains se flattant de rejeter toute prétendue « aide » ou « coopération » venant de la France, et dénoncé ici, preuves à l’appui, par diverses publications récentes[1], il n’en va pas de même du marché de l’art africain, encore plus florissant qu’il y a deux décennies, et cela justifiait les mises à jour apportées à son ancienne enquête par Ph. Baqué.
Publiée cette fois-ci en coédition avec l’association Survie, créée en 1984 en vue de dénoncer « toutes les formes d’intervention néocoloniale française en Afrique » et de prôner « une refonte réelle de la politique étrangère de la France en Afrique », elle traite relativement peu des gouvernants actuels ou récents de l’État français, de Sarkozy à Macron. De fait, ils semblent ne voir dans les objets d’art africain conservés dans les collections muséales du pays que des pions à placer sur tel ou tel échiquier diplomatico-commercial, refusant tout principe général de « restitution » et n’admettant de « retour » ponctuel, dûment voté par le Parlement, qu’à la perspective de profitables « contrats » signés par l’État destinataire. Une comparaison avec les politiques de restitution arrêtées ces dernières années en Belgique, en Allemagne, et même aux États-Unis pour les collections fédérales de la Smithsonian, aurait permis de mieux caractériser ce versant « culturel » de la « Françafrique ».
Mais il est également peu question des dirigeants africains actuels, dont certains, il est vrai, englués qu’ils sont dans des affaires de « biens mal acquis », sont assez peu légitimes pour revendiquer des « restitutions de biens culturels », une facette de plus de la « Françafrique », qui en compte nombre d’autres. Le seul que nomme Ph. Baqué est l’actuel chef d’État béninois, Patrice Talon, qui a obtenu en 2020 le « retour » de 26 œuvres saisies en novembre 1892 par les troupes françaises lors du sac d’Abomey, la capitale royale du Dahomey. Mais comme le livre le précise aussi, le Bénin ne dispose pas de musée susceptible d’exposer ces objets, et l’objectif de leur revendication aura été plutôt de les intégrer dans un programme présidentiel de développement du « tourisme de masse », projet encore imprécis et « purement mercantile », au jugement d’un universitaire béninois (p. 334).
« Un nouvel or noir ? » demande prudemment l’intitulé du premier chapitre. Ph. Baqué avance (pp. 26-27 et 67) quelques chiffres assez vagues, 80 millions d’euros pour l’ensemble des ventes publiques d’objets « d’arts premiers »en 2018, ce qui est loin de représenter tout le marché auquel il s’intéresse. Selon le site Africapresse.Paris (d’après AfricartMarket.today, 7 avril 2022), « aujourd’hui l’art africain – ancien, moderne et contemporain – qui regroupe les formes d’art et objets de l’antiquité à nos jours, est un marché florissant, avec des perspectives haussières. L’art africain a intégré tous les circuits du monde de l’art et son marché international. La France y tient une place importante en voie de consolidation. (…) Le marché de l’art africain représente de 150 à 250 millions de dollars annuels – premier et second marché réunis. Cela en fait l’un des segments les plus rentables du marché mondial de l’art dans la catégorie des arts extra-occidentaux. »
Ces évaluations sont à rapprocher du « volume moyen annuel du marché de l’art mondial réalisé entre 2009 et 2020 », estimé à 51 milliards d’euros selon Barbara Vacher (« Le marché mondial de l’art en chiffres », Boursier.com, 5 novembre 2021). S’il fallait continuer à parler d’un « nouvel or noir », il conviendrait aussi de le rapporter aux revenus que fournissent officiellement les exportations de pétrole à certains États d’Afrique de l’Ouest d’où proviennent une grande part de ces œuvres d’art : en 2018, selon l’OPEP, au prix moyen de 71 dollars le baril, 5 milliards pour le Gabon, 8 pour la République démocratique du Congo, 37 pour l’Angola, 42 pour le Nigeria… (AA.com, 27 août 2019). Au vrai, le « pactole » tout relatif procuré par ces objets paraît avoir pour source principale moins les « trouvailles » récemment parvenues sur le marché du fait de pillages ou d’exactions de diverses sortes en Afrique centrale et de l’Ouest que l’enchérissement considérable, et très souvent spéculatif, de pièces dont l’ancienneté de la présence en Occident constitue une bonne part du prestige et de la « valeur marchande ».
Ph. Baqué cite ainsi divers « records d’enchères » récents (pp. 67-69), dépassant de loin le million d’euros par objet. Ils ne cessent de s’amplifier, frôlant ou franchissant désormais la « barre » des 10 millions, comme il s’observe aussi dans les ventes publiques d’art moderne et contemporain – et ainsi qu’il se murmure à propos des transactions de gré à gré qui continuent d’échapper aux regards, sans parler du marché assez opaque et multiforme qui s’est développé sur Internet. Quand la masse monétaire mondiale se met à dépasser les cent mille milliards de dollars dont 93 à 98 %, selon les estimations, procèdent de « l’économie virtuelle »[2], il n’est guère surprenant que quelques miettes de ces milliards, « propres » ou « sales », soient employées à acquérir comme « assets » ou à « valoriser » des œuvres qui foncièrement n’ont pas de prix, et qui permettent même depuis peu de créer des « sociétés-écrans », grâce à l’innovation des tokens ou jetons[3].
« Je ne sais pas où ils trouvent l’argent », confiait en 1993 à Ph. Baqué un observateur et acteur très en vue de ce marché[4]. Il parlait là de ces marchands à la sauvette proposant de « belles pièces » en « provenance directe d’Afrique » aux passants des rues où se concentrent, à Paris, à Bruxelles et ailleurs, les galeries « d’arts premiers »… scènes qui s’observent encore, en dépit des restrictions actuelles sur les visas et les importations d’objets d’art. « Où ils trouvent l’argent », marchands et clients, l’interrogation prend un poids passablement plus conséquent trois décennies plus tard, avec l’enchérissement colossal des pièces réputées « authentiques » et l’accroissement proportionnel des « frais généraux » induits par leur commerce, expertises sophistiquées, catalogues luxueux, foires-expositions spécialisées se succédant presque tout au long de l’année d’un point du globe à l’autre, coûts de transport, d’assurance, de garde-meubles ou de « port franc »…, le tout relevant bien sûr du « secret des affaires ». Lequel protège également les acquéreurs, ou les « consommateurs » ainsi que les dénomme ce livre[5], spécialement les plus fortunés.
Ph. Baqué ne pouvait donc pousser très loin ses investigations sur de tels aspects économico-financiers, et son livre se situe principalement sur un plan historique, politique et moral. Personne ne pourra sérieusement contester sa conclusion (pp. 355-363) : qu’on y ajoute ou non les préfixes « post » ou « néo ». il s’agit d’une « exposition coloniale » prolongée jusqu’à nos jours, toujours justiciable des invectives que leur réservait le célèbre tract surréaliste de 1931. Selon une autre expression d’André Breton[6], elle s’accompagne aussi d’« inversion de signe » quand le seul fait d’avoir figuré dans un court métrage anticolonialiste de 1951, Les statues meurent aussi de Chris Marker et Alain Resnais, devient un argument majeur de « valorisation » d’un appuie-nuque Luba en vente publique. Néanmoins, comme le concède Ph. Baqué, « le chaos engendré par les groupes armés, les guerres et les immenses zones échappant à tout contrôle encouragent le trafic pourvoyeur d’argent et d’armes. L’Afrique n’est pas seule à souffrir de ce pillage. Pas une région de la planète, pas une culture n’y échappe »…
On ajoutera que, parmi les maux que l’Occident a infligés et fait toujours subir à l’Afrique, ce pillage n’est sans doute pas le plus physiquement et immédiatement douloureux, et que d’autres réclament avec plus d’évidence des remèdes d’urgence. Reste qu’il est important de prendre la mesure de chacun d’eux, et le livre de Ph. Baqué y contribue de façon notable.
Gilles Bounoure
[1] La plus remarquable et instructive est L’Empire qui ne veut pas mourir. Une histoire de la Françafrique, ouvrage collectif sous la direction de Thomas Borrel, Amzat Boukari-Yabara, Benoît Collombat et Thomas Deltombe, Paris, Le Seuil, 2021, 1 008 p., 25 €.
[2] Données de 2021. Proportions déjà observées en 2007 selon Olivier Berruyer, « La déconnexion de l’économie financière », les crises.fr, 15 avril 2013.
[3] Sur les tokens et certaines grandes tendances du marché contemporain de l’art, voir « L’art, instrument moins financier qu’idéologique », lesdosssiers-contretemps.org, 25 septembre 2021. Dénués de « valeur faciale », les « assets » ou « actifs » sont particulièrement sujets à des krachs, comme il vient d’advenir à beaucoup de « cryptomonnaies ».
[4] Raoul Lehuard, créateur et directeur du trimestriel Arts d’Afrique noire-Arts premiers (1972-2004, revue qui subsistait principalement des abonnements des marchands d’art et des publicités qu’ils y inséraient pour « valoriser » les objets qu’ils présentaient), interrogé en 1993, p. 76.
[5] Ph. Baqué s’y intéresse assez peu, en dépit des pratiques ostentatoires de certains d’entre eux, à l’instar de l’ancien dirigeant de L’Oréal reconverti dans la finance, Marc Ladreit de Lacharrière, constituant en une décennie une collection pour en faire don au musée du quai Branly sous condition d’y avoir une salle à son nom. Le livre consacre néanmoins aux acquisitions spéculatives quelques pages (par exemple pp. 184-188) qui auraient mérité une mise à jour plus complète, voire une enquête à nouveaux frais. Les marchands et acteurs spécialisés qu’il a interrogés au début des années 1990 restaient sous le coup d’un récent effondrement du marché de l’art, bien oublié aujourd’hui. À cette époque, « économie réelle » et « économie virtuelle » étaient encore à peu près en interdépendance… Par ailleurs, les méthodes de « valorisation » des objets se sont considérablement affinées depuis lors, ainsi que le suggère son chapitre sur « un marché en perspective », notamment à propos des « chercheurs de provenance ».
[6] Il faut regretter que l’auteur n’ait pas profité de cette nouvelle édition pour corriger les « jugements injustes » qu’il porte sur Breton pp. 48-57, relevés d’emblée par Odile Falgine (Le Monde diplomatique, février 2000) qui rappelait que Breton avait été « obligé de vendre des objets pour vivre ». De nombreuses recherches, souvent à charge, ont été menées sur les prétendues « activités marchandes » du poète. Une des plus sérieuses concluait récemment : « On observe que la spéculation sur ces statuettes n’entrait pas dans les motivations de Breton : avec une moins-value de 40 % entre le prix d’achat de l’oiseau-totem en 1928, et son prix d’adjudication en 1931, Breton aurait pu retirer l’objet des enchères, ne payant ainsi que les frais acheteurs, mais il ne le fit pas. Le procès-verbal de la vente témoigne de moins-values encore plus fortes, et de rares cas de plus-value ». Élodie Vaudry, Léa Saint-Raymond, « De l’Adu Zatua à l’« oiseau-totem ». L’Océanie esthétique et marchande des surréalistes », dans J. Drost, F. Flahutez et M. Schieder (éd.), Le surréalisme et l’argent, Paris, Centre allemand d’histoire de l’art, 2021, p. 180-192, ici p. 187.


