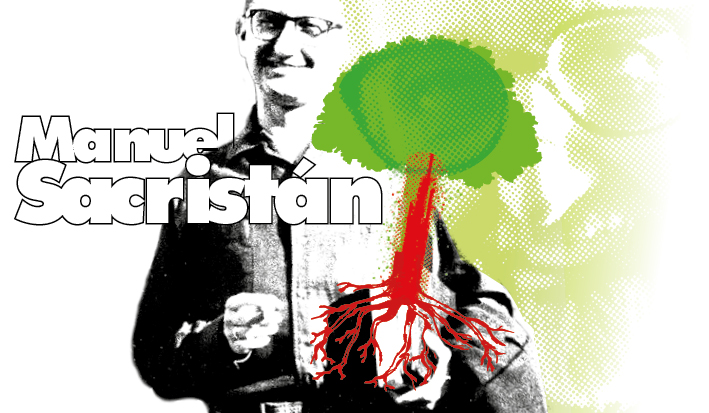
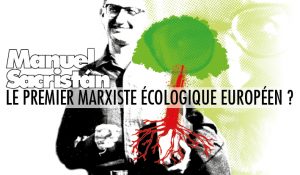
Enric TELLO est historien de l’Économie et de l’Environnement, professeur à l’Université de Barcelone, membre de l’Observatoire pour l’Action et la Recherche en Alimentation (FARO) de l’UB.
Il n’est pas facile d’expliquer aux nouvelles générations nées après la chute du Mur de Berlin en 1989 que Manuel Sacristán (1925-1985) fut le philosophe marxiste espagnol le plus important de sa génération et, en même temps, l’un des rares pionniers à avoir nagé à contre-courant en introduisant en Espagne au dernier quart du XXe siècle les nouvelles visions de l’écologie politique et du pacifisme antinucléaire. Ce n’est pas facile, tout d’abord parce que la plupart des gens ont tendance à croire que le marxisme, l’écologisme et le pacifisme sont des visions du monde différentes qui s’excluent l’une l’autre. Et ce n’est pas un hasard, car la plupart de ce qui a été dit et fait au nom du «marxisme» et du «socialisme» depuis que Staline prit la tête du parti communiste de l’Union Soviétique dans les années 1930 jusqu’à la dissolution de l’Union Soviétique en 1991, a contribué sans aucun doute à entretenir cette croyance. Le processus d’industrialisation accélérée de l’ancien empire russe, entrepris par l’État soviétique en excluant toute forme de contrôle démocratique et en remplaçant toute forme de marché par une planification économique centralisée par un État totalitaire, était loin de prendre en considération les besoins humains et la durabilité écologique. Ses impacts socio-écologiques se sont avérés, à long terme, comparables, voire pires que ceux entraînés par les processus d’industrialisation capitalistes.
Écologistes et marxistes dans la Barcelone des années 1970
Mais les faits sont têtus, et il est indéniable que Sacristán commença à réfléchir sur l’écologie dans une perspective marxiste alors que la gauche sociale et politique mondiale la méprisait encore totalement, aussi bien les sociaux-démocrates que les communistes officiels plus ou moins proches de l’Union Soviétique. De manière étonnante, cette réflexion eut lieu là où on s’y attendait le moins: dans une Barcelone sous la dictature franquiste jusqu’en 1975, et à partir de 1978 et le dernier quart du XXe siècle pendant la transition vers la monarchie parlementaire actuelle. Tout au long de cette période, Sacristán a été profondément impliqué dans la lutte clandestine contre le régime franquiste, pour la liberté et pour un socialisme renouvelé. Quarante ans se sont écoulés depuis sa mort sans que l’on se soit posé la question suivante: peut-on considérer Manuel Sacristán comme le premier marxiste écologique post-stalinien en Europe ?
Le Comité Antinucléaire de Catalogne, dont Sacristán fut un membre actif, organisa dans la Faculté d’Économie de l’Université de Barcelone en novembre 1979 un séminaire sur la crise énergétique dans la société capitaliste. Ce séminaire, qui s’est tenu dans le contexte de la crise pétrolière et du débat suscité par les deux premiers rapports au Club de Rome sur les limites de la croissance, s’est ouvert par une conférence de Joan Martínez Alier sur l’énergie et l’économie agraire [1], et s’est clôturé par une conférence de Manuel Sacristán qui avait pour titre : « Pourquoi y a-t-il si peu d’économistes dans le mouvement écologiste? »[2]. Avec cette question, Sacristán poursuivait deux objectifs : attirer l’attention des écologistes sur l’intérêt de développer leurs propres objectifs sur une base économique plus solide, et combattre les « inhibitions méthodologiques » des économistes néoclassiques conventionnels à propos de rôle des facteurs écologiques dans l’économie.
Martínez Alier et Sacristán se connaissaient bien, ayant été respectivement élève et professeur, et s’appréciaient mutuellement.[3] À l’époque, tous deux introduisaient des idées écologistes en Espagne, en collaboration avec l’économiste écologique José Manuel Naredo et un petit groupe d’écologistes et d’épidémiologistes. Ce séminaire donna lieu à une situation ironique. D’une part, Manuel Sacristán se demandait pourquoi il n’y avait pas d’économistes dans le mouvement écologiste, alors qu’il avait invité l’économiste Joan Martínez Alier, qui ouvrait à l’époque la voie au nouveau domaine de l’économie écologique qui commençait à prendre forme à partir des travaux de Nicholas Georgescu-Roegen. De son côté, Joan Martínez Alier se demandait également pourquoi il n’existait pas de marxisme écologique, en rappelant l’adhésion d’Engels et de Marx à la « croissance des forces productives » comme levier pour parvenir à une transformation socialiste. Il formulait cette critique en présence de Manuel Sacristán, qui avait participé à l’organisation de ce séminaire en tant que membre du Comité Antinucléaire et qui développait une réflexion écologiste originale d’un point de vue marxiste.
À cette époque, Joan Martínez Alier était en train d’écrire ce qui allait devenir son livre le plus connu et le plus cité, Ecological Economics, publié en 1987 [4]. Dans la première version en catalan, publiée en 1984, il considérait encore le marxisme comme une tradition de pensée sociale et politique sans lien possible avec l’écologie politique:
« Les fondateurs du marxisme ont défini une conception de la science qui sépare l’étude de l’histoire économique et l’histoire de l’économie de l’histoire des sciences naturelles. Cette science reposait sur des concepts tels que le développement des forces productives, la production ou la théorie de la valeur-travail, qui sont totalement et volontairement séparés – comme le démontrent les commentaires d’Engels [sur l’œuvre de Podolinsky que nous aborderons plus loin] – des problèmes écologiques et énergétiques qui sous-tendent tout système économique. D’un côté, ils ont créé – ou adopté – des outils idéologiques qui ont aidé les marxistes à défendre l’idéologie bourgeoise du progrès, contribuant ainsi à la propagation du mythe de la croissance; de l’autre, ils ont convaincu les pays dits socialistes de reporter leur lutte pour l’égalité dans l’espoir que la croissance ininterrompue de la production (ou plutôt la destruction des ressources naturelles ?) mènerait à un communisme prospère. »
Dans les éditions et adaptations ultérieures de son ouvrage, Joan Martínez Alier nuança ces affirmations à la lumière de nouvelles expériences et de la découverte de textes ignorés ou oubliés de Marx. Son édition espagnole de 1991 de La ecología y la economía incluait une réévaluation de l’œuvre de Marx et de ce que Manuel Sacristán avait appelé ses « intuitions écologiques ». Dans une postface politique, il reconnaissait qu’un marxisme écologique pouvait exister en tant que possibilité intellectuelle : « Même si l’on peut trouver chez Marx certaines intuitionss écologiques, je pense que le marxisme et l’écologisme restent distincts. L’axe analytique qui pourrait les rapprocher pourrait être la redéfinition des concepts marxistes de forces productives et de conditions de production, comme James O’Connor et moi-même l’avons souligné […] ».[5]
Les revues Materiales et mientras tanto
Peut-être que Martínez Alier ne considérait pas encore Mientras tanto comme une revue écosocialiste, ou peut-être ne croyait-il pas qu’elle eut un impact international puisqu’elle était publiée en espagnol (et, occasionnellement, en catalan). Ou peut-être a-t-il simplement oublié de mentionner ses amis écologistes de Barcelone qui avaient commencé à réfléchir au socialisme écologique bien avant la plupart des penseurs de gauche dans le monde anglo-saxon.[6] Le premier numéro de Mientras tanto fut publié en novembre 1979, à la même date où se tenait le séminaire à la Faculté d’Économie mentionné ci-dessus, avec un article de Sacristán dans lequel il écrivait ce qui suit:
« De la manière dont nous avons finalement appris à regarder la Terre, nous savons que l’agent [de l’émancipation sociale] ne peut avoir pour tâche fondamentale de “libérer les forces productives de la société”, prétendument enchaînées par le capitalisme. Nous avons cessé d’admettre la coïncidence mystique entre le développement objectif de la société et les fins communistes, coïncidence à laquelle croyait encore Lénine, par exemple. Nous savons maintenant que nous devons gagner intégralement la nouvelle Terre par le travail de nos mains ». Et il ajoutait que « la révision nécessaire de la conception du sujet révolutionnaire dans les sociétés industrielles devra fonder la conscience de classe ouvrière non seulement sur la négativité qu’une partie de la classe a surmonté, dans ces pays, grâce à ses luttes et à l’évolution du système, mais aussi sur la positivité de sa condition de soutien de l’espèce, de conservatrice de la vie, d’organe indispensable du métabolisme de la société avec la nature ».[7]
Toujours en 1979, Manuel Sacristán fut interviewé à l’occasion de la première grande manifestation contre les centrales nucléaires organisée dans les rues de Barcelone. Dans cette interview, il affirmait que «le socialisme court à la catastrophe s’il n’assimile pas la motivation écologique-révolutionnaire, même si celle-ci doit à son tour assimiler et comprendre qu’une révolution sociale est nécessaire».[8] Dans une autre interview accordée a la revue mexicaine Dialéctica, publiée par l’Université de Puebla en 1983, il résumait le projet écosocialiste de la revue Mientras tanto en ces termes : « Au premier plan, au centre de ce que nous faisons – pas seulement moi, mais tout un collectif – se trouve la revue Mientras tanto, avec laquelle nous essayons, très modestement – car nous n’avons jamais vendu plus de 3 500 exemplaires d’un numéro – , de préparer le terrain pour réfléchir d’un point de vue socialiste aux nouveaux problèmes de la civilisation contemporaine, des problèmes non prévus par les penseurs classiques – et peut-être imprévisibles pour eux – , et déterminés par le développement de certaines forces productives et destructrices modernes, en particulier technologiques ».[9]
La revue Materiales, également fondée par Manuel Sacristán et publiée entre 1977 et 1978, avait précédé Mientras tanto. Elle publia la critique du « socialisme réel » par Rudolf Bahro, c’est-à-dire, par quelqu’un qui avait vécu en Allemagne de l’Est. La revue publia également une analyse du livre de James O’Connor, La crise fiscale de l’État par le Bay Area Group des États-Unis. Deux auteurs très importants dans une perspective écosocialiste attirèrent également l’attention de Materiales : Wolfgang Harich et Barry Commoner.
Manuel Sacristán appréciait les travaux de Harich sur la littérature et la politique, et connaissait bien sa situation de marxiste dissident, condamné en Allemagne de l’Est à dix ans de prison en 1957 pour ses critiques de la répression militaire contre les révoltés de 1956 en Pologne et en Hongrie. Il s’intéressa immédiatement au livre controversé de Harich, Kommunismus ohne Wachstum?, de 1975, traduit en espagnol et publié en 1978 sous le titre de ¿Comunismo sin crecimiento? Babeuf y el Club de Roma. Dans sa préface, Sacristán soulignait que « tout communiste qui voit dans le problème écologique l’élément fondamental du problème de la révolution (comme c’est le cas de Harich) est obligé de réviser la notion de communisme ».[10] Cependant, Sacristán était en profond désaccord avec la perspective autoritaire que Harich considérait comme inévitable pour satisfaire les besoins humains de manière égalitaire dans un contexte économique et écologique où il devient impératif de freiner la croissance des « forces productives et destructrices ». Si la reconnaissance de la crise écologique conduisit Harich, un dissident antistaliniste, à « supprimer l’élément de liberté et compenser sa perte en augmentant l’élément égalitaire », Sacristán – aux côtés de Giulia Adinolfi avec qui il partageait un point de vue marxiste-féministe – choisit d’aborder le problème du pouvoir politique dans une perspective gandhienne, non violente, fédérale et plus libre. Comme le déclara Sacristán lors d’un débat public avec Harich à Barcelone en 1979 :
«[…] l’essentiel c’est peut-être d’assimiler une conception stratégique qui est souvent méprisée sous l’étiquette de gandhisme. Car il convient de dire crûment des choses assez claires dès maintenant; principalement, qu’à ce stade du XXe siècle, si l’on s’en tient aux pays industrialisés, c’est-à-dire sans prétendre inclure dans ces considérations les peuples qui supportent en dernier ressort l’oppression et l’exploitation impérialistes, il est grand temps, voire peut-être trop tard, de reconnaître que la capacité révolutionnaire, qualitativement transformatrice, des traditions les plus solides du mouvement ouvrier s’est révélée faible. Pour le dire de manière un peu provocante, on ne voit pas que la IIIe Internationale (ni la IVe d’ailleurs) se soit rapprochée de ses objectifs doctrinaux plus que le gandhisme des siens. Mais, en outre, l’exploitation des expériences que j’appelle, pour faire court, gandhiennes peut servir à façonner la nécessaire révision des conceptions révolutionnaires dans un sens qui leur ajoute la conscience d’une alternative radicale ».[11]
Dans sa préface au livre de Harich, Sacristán fait également référence à certains auteurs socialistes qui commençaient à remettre en question l’adhésion à la croissance économique comme levier de transformation sociale : «Depuis environ cinq ans, on observe des courants de pensée marxiste communiste très visibles qui s’accordent sur une révision de la manière ou de la mesure dans laquelle les classiques du marxisme considèrent comme de simples données certaines caractéristiques de la civilisation capitaliste, en particulier la croissance illimitée des forces productives matérielles, la production ricardienne pour la production dans laquelle Marx vit à un moment donné la dynamique fondamentale de la liberté». Il mentionne spécifiquement quelques uns des « auteurs marxistes de la revue américaine Science for the People »[12]; et il convient de rappeler que Materiales publia en 1978 un article de Barry Commoner sous le titre « Le plan énergétique du président Carter : notre sombre avenir ».[13] Il est probable que la lecture précoce de Science and survival (1970, traduit en espagnol en 1975) et de The closing circle (1971 et 1973, respectivement), de Barry Commoner, ait aidé Sacristán à formuler explicitement la crise écologique comme une question-clé du socialisme.[14]
Bien avant son engagement politique Sacristán avait montré de l’intérêt pour l’environnement, probablement associé à son goût pour la randonnée en montagne. Il aimait observer le paysage et l’empreinte paysanne sur la terre. Il montra également de l’intérêt pour les cultures et les luttes des peuples originaires de l’Amérique, comme ceux de Geronimo (Goyaałé) et des Apaches Mescalero-Chiricahuas.[15] Dans une réflexion introspective tirée de ses notes de terrain lors d’une randonnée en 1973, il exprimait ainsi l’attrait qu’il ressentait pour le travail paysan par rapport à d’autres formes de travail plus aliénantes sous le capitalisme :
« Je crois enfin connaître la racine de leurs traits qui me plaisent davantage que ceux des producteurs capitalistes (y compris les ouvriers et plus encore les employés): les gens qui s’occupent de la cueillette, la chasse, les activités pastorales ou le travail paysan travaillent directement pour leur subsistance (et leur logement). Ce n’est pas le cas du producteur industriel (en général). Et lorsqu’il le fait (industrie de la construction, agriculture industrialisée), la généralisation de la marchandise fait que ce soit uniquement par hasard qu’il va manger ou utiliser quelque chose de ce qu’il produit, ni l’échanger matériellement contre quoi que ce soit. Je pense que ce qui est répugnant, c’est le travail abstrait, déjà “avant” une division [du travail] avancée. Je pense ici à un “avant” logique, mais peut-être aussi historique – comme c’est le cas avec l’esclavage».[16]
Des forces « productives » aux « forces productives-destructrices »
Ainsi, au cours des années 1970, Sacristán souligna la nécessité de revoir certains aspects clés de la tradition marxiste face à l’évidence de la crise écologique mondiale en cours. Il reconnut ouvertement l’ambiguïté intrinsèque de ce que Marx et Engels appelaient les « forces productives », qui sont aussi et ont toujours été « destructrices » d’un point de vue écologique. Il commença à les appeler « forces productives-destructrices » et en assuma toutes les conséquences pour une écologie politique marxiste:
« Je pense que le modèle marxiste du rôle des forces productives dans le changement social est correct; je pense que l’histoire connue corrobore la conception marxiste, qui est cohérente sur le plan théorique et plausible sur le plan historique et empirique. Je ne pense donc pas qu’il soit nécessaire de réviser ces thèses. […] La nouveauté réside dans le fait que nous avons désormais des raisons de soupçonner que le changement social auquel nous sommes confrontés ne sera pas nécessairement libérateur simplement en raison de l’effet de la dynamique […] du modèle marxiste. Nous n’avons aucune garantie que la tension entre les forces de production-destruction et les rapports de production actuels doive avoir comme résultat des perspectives émancipatrices. Le contraire pourrait également se produire ».
Il exprima « la situation problématique que l’efficacité des forces productives-destructrices en développement pose pour une perspective socialiste aujourd’hui » de la façon suivante :
« Ainsi, […] le niveau auquel il est nécessaire de reconsidérer un certain optimisme progressiste présent dans les traditions socialistes, provenant du XVIIIe siècle, est celui de l’évaluation politique. Le problème réside dans la manière de réagir politiquement à la tension actuelle entre les forces productives et destructrices en développement et les rapports de production existants. Et je pense que la clé d’une solution adéquate consiste à prendre ses distances par rapport à une réponse simpliste fondée sur une foi inébranlable dans la direction émancipatrice du développement des forces productives et destructrices ».
Lorsque l’interviewer lui demande si cela signifie atteindre les limites de la pensée marxiste, il répond : « Je ne pense pas que le dernier mot de Marx sur toutes ces choses dont nous discutons soit clair. Je pense que, malgré son aspiration permanente à produire une œuvre littéraire très aboutie – ce qui est l’une des raisons pour lesquelles il a laissé un si grand nombre de manuscrits inédits -, Marx est mort sans avoir achevé sa pensée, sans avoir fait la paix avec lui-même ». Il ajoute que « la dernière partie de sa vie coïncide avec une transition importante dans la connaissance scientifique », et souligne la correspondance tardive de Marx avec la néo-populiste Véra Zassoulitch sur le rôle de la communauté rurale russe dans la voie au socialisme, ou ses objections mélancoliques à l’introduction du chemin de fer dans les vallées affluentes du Rhin :
« Il existe une distance qui n’est pas théorique – c’est-à-dire qui ne se rapporte pas à l’explication du réel – mais politique, qui concerne la construction de la nouvelle réalité. Je reconnais que des réflexions analogues du vieux Marx – la lettre à Véra Zassoulitch ou la lettre à Engels sur les chemins de fer- m’ont ouvert la voie pour penser qu’il n’y a pas de contradiction entre le maintien du modèle de Marx concernant l’action du développement des forces productives et destructrices et sa collision avec les rapports de production, et une conception politique socialiste qui ne repose pas aveuglément et sans discernement sur le développement des forces productives et destructrices, mais qui conçoit la fonction de la gestion socialiste […] comme l’administration de ces forces, et non comme la simple élimination des obstacles que leur opposent les rapports de production actuels. Il me semble que, ainsi formulée, cette conception est tout à fait cohérente avec l’idée d’une société socialiste, d’une société régulée».[17]
Il est encore choquant aujourd’hui de découvrir, à la fin du chapitre XIII du Capital, où Marx conclut son analyse sur « La machine et la grande industrie », l’affirmation selon laquelle le capitalisme bloque l’échange métabolique avec la nature en empêchant le sol de se reconstituer avec les nutriments extraits par les aliments et les fibres qui y sont cultivés, dégradant ainsi sa fertilité. Il rapproche ensuite cette exploitation du sol (aujourd’hui qualifiée d’insoutenable) à la détérioration de la santé des travailleurs industriels et agricoles, considérant qu’elle résultait de la même dynamique des forces productives capitalistes qui sapent les conditions d’un échange métabolique durable (aujourd’hui qualifié de « viable ») avec la nature : « La production capitaliste ne développe la technique et la combinaison du processus social de production qu’en minant en même temps les sources d’où provient toute richesse : la terre et le travailleur ». De cette considération écologique surprenante, Marx tire ensuite la conclusion politique que, dans un avenir communiste, les « producteurs associés » devront délibérément rétablir un métabolisme durable avec les systèmes naturels « comme loi régulatrice de la production sociale, et sous une forme adaptée au plein développement humain ».[18]
Il s’agit là d’une des rares occasions où Marx s’est permis d’enfreindre la restriction qu’il s’était imposée de ne jamais parler concrètement de ce que serait une future société socialiste, ni des tâches qu’elle devrait accomplir. Dans d’autres de ces occasions exceptionnelles, Marx définit le communisme comme un moyen d’établir une régulation consciente du métabolisme social afin de parvenir au développement humain avec un minimum de dépense énergétique. Nous savons aujourd’hui que, dans ce passage et dans d’autres passages de ses « aperçus écologiques », Karl Marx a été le premier auteur à utiliser le terme « métabolisme social » pour désigner les interactions socio-écologiques avec le reste de la nature.[19]
Les inhibitions méthodologiques hégéliennes de Marx, Engels et du marxisme
Dans l’article « Algunos atisbos político-ecológicos de Marx », publié en 1984 dans Mientras tanto, Manuel Sacristán cherche à comprendre pourquoi les idées écologiques de Marx ont été culturellement oubliées et sont restéespolitiquement écartées pendant un siècle. Sacristán identifie comme principal obstacle l’origine hégélienne de la pensée de Marx. Par exemple, en commentant les textes sur la fracture métabolique ouverte par l’agriculture capitaliste, Sacristán affirme :
« La réflexion de Marx a l’intérêt de ne pas s’inscrire dans ses schémas de pensée habituels. […] Il y a donc dans la pensée de Marx certains motifs (un peu plus que des intuitions) qui dépassent l’écologie du travail sous le capitalisme. Mais, en outre, Marx a tenté d’utiliser ces motifs pour comprendre ce que devrait être la société socialiste. […] Marx part d’une conviction très pessimiste : qu’au moment de construire une société socialiste, le capitalisme aura détruit complètement le rapport correct de l’espèce humaine avec le reste de la nature (entendant par « correct », de manière pragmatique, le rapport adéquat pour la survie de l’espèce [humaine]). Il assigne alors à la nouvelle société la tâche – dit-il littéralement – de “produire systématiquement” cet échange entre l’espèce humaine et le reste de la nature, en considérant comme loi fondamentale régissant la production sous une forme adaptée à ce qu’il appelle […] “le plein développement humain”. La société socialiste est ainsi caractérisée comme celle qui établit la viabilité écologique de l’espèce ».[20]
Sacristán explique par la suite comment Marx, influencé par Hegel, avait adopté face à cette destruction écologique mondiale un pessimisme profond consistant à accepter que l’histoire avance aveuglément « du mauvais côté » :
« Pourquoi un texte aussi catégorique et inquiétant n’a-t-il pas eu de suite, puisqu’il exprime l’hypothèse que le capitalisme ne disparaîtra pas avant d’avoir totalement détruit le métabolisme durable entre l’espèce humaine et la nature ? […] L’une des causes de ce manque d’intérêt réside probablement dans le substrat philosophique hégélien de la pensée de Marx lui-même. Marx a hérité de Hegel une façon de penser d’un déterminisme particulier, fondée sur l’idée que les événements se produisent avec une logique interne, avec une nécessité absolue, l’idée qu’il n’y a pas de distinction entre le logique et l’empirique, que les faits sont en eux-mêmes logiquement nécessaires. C’est l’idée exprimée dans la célèbre phrase, maintes fois répétée : “Tout ce qui est réel est rationnel”. En plus, cette logique ou cette nécessité que la philosophie hégélienne attribue aux événements, à l’histoire, agit moyennant la négativité : elle construit une dynamique dans laquelle le moteur du changement, le moteur du processus historique, c’est ce que les hégéliens appellent la négation ».[21]
Ainsi, l’«inhibition méthodologique» dont Marx, Engels et leurs disciples ont souffert lorsqu’ils ont été confrontés à « l’aperçu écologique » de la destruction capitaliste de l’environnement, résidait dans les fondements hégéliens profonds de leur propre philosophie, les empêchant dans la plupart des cas de développer leur propre vision socio-écologique. S’ils l’avaient fait, ils auraient dépassé la vision déterministe hégélienne de l’histoire. Cet argument méthodologique de Sacristán aide à mieux comprendre pourquoi Marx s’est approché à la fin de sa vie des limites de ses propres racines philosophiques hégéliennes, des limites mêmes qui ont entravé ses avancées théoriques et politiques vers l’écologie politique, sans presque jamais les dépasser, sauf dans une succession d’« aperçus écologiques » sans doute très intéressants mais partiels.
On considère souvent le schéma matérialiste-hégélien de Marx et Engels comme la clé qui introduit une vision dialectique et dynamique dans leur façon de penser. Manuel Sacristán a très bien distingué deux notions différentes de dialectique. Face au déterminisme téléologique de la dialectique hégélienne, Sacristán a observé dans l’œuvre de Marx et Engels une autre manière distincte de comprendre la dialectique, en tant qu’aspiration à aller au-delà de la simple connaissance scientifique analytique et réductrice. Cette autre dialectique « s’inspire moins de la démarche scientifique positive que des limites de celle-ci »:
En effet, « précisément parce qu’ils reposent sur une analyse réductrice qui laisse de côté – par abstraction – la particularité qualitative des phénomènes complexes soumis à l’analyse et à la réduction, les concepts de la science au sens strict – c’est-à-dire la science positive moderne – sont invariablement des concepts généraux qui trouvent leur place dans des énoncés non moins généraux, des “lois” comme on dit, qui renseignent sur des classes entières d’objets. Cette connaissance ignore des éléments décisifs pour l’individualisation des objets connus. Cela n’est pas dû à une limitation accidentelle, mais à la présupposition définitoire de la méthodologie analytique-réductrice, qui ne répond qu’au principe matérialiste d’explication de toute formation complexe, qualitativement variée, par des facteurs naturels plus ou moins homogènes.
Les “totalités” concrètes et complexes n’apparaissent pas dans l’univers du discours de la science positive, bien que celle-ci fournisse tous les éléments nécessaires à leur compréhension rationnelle. Ce qu’elle ne fournit pas, c’est leur totalité, leur consistance concrète. Or, le champ ou domaine de pertinence de la pensée dialectique est précisément celui des totalités concrètes. Hegel a exprimé cette motivation avec son langage poétique en disant que la vérité est le tout.
La conception du monde doit nécessairement donner une certaine compréhension des totalités concrètes. Car la pratique humaine n’est pas seulement confrontée à la nécessité de penser la réalité de manière analytique et réductrice, mais aussi à celle de traiter et de comprendre les concrétisations réelles, ce que la science positive ne peut saisir ».[22]
Ces lignes ont été écrites et publiées en 1968. Nous savons aujourd’hui que la manière dont Manuel Sacristán appréhendait la dialectique reprenait, d’une part, l’ambition d’Otto Neurath et des autres membres du Cercle de Vienne de composer une « orchestration des sciences » qui conduirait à une « science unifiée » qui aiderait les gens à comprendre leur société et à participer à sa transformation et à sa planification.[23] D’autre part, la notion socratique de dialectique de Sacristán est désormais clairement liée au dialogue transdisciplinaire des savoirs et aux analyses multicritères pour prendre des décisions au moyen de processus délibératifs bien informés dans le cadre de la nouvelle science de la durabilité.[24]
Cependant, la pensée hégélienne de Marx et Engels était une chose, et ce qui s’est passé ensuite avec leurs disciples en était une autre. Le blocage hégélien qui empêchait de prendre au sérieux les problèmes de l’écologie politique déjà signalés par Marx est resté un obstacle pour presque tous, ce qui a conduit Sacristán à poser la question clé sur la trajectoire ultérieure de cette tradition intellectuelle et politique : « Des générations et des générations de marxistes et de marxologues ont parcouru ces pages en s’attardant sur les autres choses qu’elles contenaient, à savoir que le capitalisme technicise l’agriculture, réduit la population agricole, etc., mais sans jamais prêter attention à ce que ces pages disaient sur la relation entre l’espèce humaine et la nature ». Le substrat hégélien continuait d’inhiber un marxisme écologique car « l‘acceptation du schéma de la progression par le mauvais côté est, en tout état de cause, peu compatible avec un programme d’écologie politique : si les choses doivent progresser par leur mauvais côté, dira-t-on, laissons-les continuer à empirer. […] Cela n’explique certainement pas tout, mais il est très probable que la racine du faible écho que la tradition marxiste a donné aux aperçus d’écologie politique présents dans l’œuvre de Marx réside dans l’élément hégélien de sa philosophie. Toute continuation utile de la tradition de Marx doit commencer par abandonner le schéma dialectique hégélien de la philosophie de l’Histoire ».[25]
Ce fondement hégélien explique également pourquoi Marx et Engels considéraient comme une perte de temps toute tentative d’explorer la conception future d’une société communiste, ou même d’une transition socialiste. À la suite de Hegel, ils croyaient que « l’histoire tranchera ». Cette attitude téléologique finit par renforcer ce que Sacristán appela une perspective « millénariste », « eschatologique » ou « quiliastique » de la révolution, qui doit être dépassée pour faire face à la crise socio-écologique de notre temps :
« La principale conversion que les contraintes écologiques imposent à la pensée révolutionnaire consiste à abandonner l’attente du Jugement dernier, l’utopisme, l’eschatologie, à se débarrasser du millénarisme. Le millénarisme, c’est croire que la révolution sociale est l’aboutissement des temps, un événement à partir duquel toutes les tensions entre les personnes et entre celles-ci et la nature seront résolues, car les lois objectives de l’être, bonnes en elles-mêmes, mais jusqu’à présent déformées par l’état de péché d’une société injuste, pourront alors agir sans obstacle. […] Nous devons reconnaître que nos capacités et nos besoins naturels sont susceptibles de s’étendre jusqu’à l’autodestruction. Nous devons voir que, biologiquement, nous sommes l’espèce de l’hybris, du péché originel, de l’orgueil : l’espèce exagérée, l’espèce de l’excès ».
Sacristán en tira une conclusion politique importante :
« À en juger par la complexité de la tâche fondamentale décrite, l’action de l’agent révolutionnaire devra être décrite d’une manière beaucoup moins faustienne et davantage inspirée par des règles de conduite issues d’une tradition archaïque. Une tradition tellement archaïque qu’elle peut se résumer dans l’une des maximes de Delphes : “Rien en excès” […] de sorte que si cette réflexion n’est pas tout à fait erronée, nous devrons nous proposer de renverser certaines valeurs de la tradition révolutionnaire moderne ».[26]
Cela a conduit en 1979 Manuel Sacristán, Giulia Adinolfi et Paco Fernández Buey, avec d’autres membres de la rédaction, à poser dans le premier numéro de Mientras tanto la question révolutionnaire clé de notre temps : se mettre au travail pour «la tâche qu’il faudrait se proposer afin que, après cette nuit obscure de la crise d’une civilisation, on assiste à l’éveil d’une humanité plus juste sur une Terre habitable, au lieu d’un immense troupeau d’abrutis dans un bruyant dépotoir chimique, pharmaceutique et radioactif ».[27] Si nous voulons donner une véritable chance au socialisme, nous devons commencer par mettre la crise écologique mondiale au premier plan.
L’écologie de Marx, Podolinsky et l’absence d’un marxisme écologique pendant un siècle
Si l’écologie était si centrale dans l’idée que Marx se faisait de la tâche à accomplir par une société communiste, pourquoi la tradition marxiste a-t-elle mis si longtemps à admettre que le concept de métabolisme social puisse devenir un outil opérationnel grâce à l’utilisation de la comptabilité économique et écologique des flux de matière et d’énergie ? C’est Nicholas Georgescu-Roegen qui a dû relancer cette analyse du métabolisme social à partir de zéro, dans son ouvrage La loi de l’entropie et le processus économique, publié en 1971. Pourquoi les courants marxistes ultérieurs n’ont-ils jamais accordé la moindre importance théorique et politique à ces affirmations pendant un siècle après la mort de Marx en 1883 ?
Karl Marx n’a jamais terminé Le Capital après le grand succès du premier volume publié en 1867. Qu’a-t-il fait pendant les seize années qui ont précédé sa mort en 1883 ? Il passa de longues heures à la bibliothèque du British Museum de Londres à remplir une quantité extraordinaire de cahiers manuscrits avec ses notes de lecture – une pratique habituelle chez lui depuis sa jeunesse – et à répondre aux nombreuses lettres qu’il recevait de différentes parties du monde. Certains extraits de ces cahiers ont été sélectionnés par Friedrich Engels pour l’édition du deuxième et du troisième volume du Capital en 1885 et 1894. Mais bien d’autres textes de ses cahiers et ses lettres ont été publiés beaucoup plus tard, certains seulement récemment, sans compter qu’il y en a qui restent encore inédits.
Certains des cahiers de Marx étaient consacrés à l’apprentissage des mathématiques, ce qui suggère qu’une partie de la réponse à la question de savoir pourquoi il n’a jamais terminé Le Capital pourrait être liée à sa conscience du changement de paradigme qui a conduit de l’économie politique classique aux modèles néoclassiques après 1870. Une autre partie importante de la réponse réside dans le fait qu’il était très intéressé par l’approfondissement de questions socio-métaboliques telles que les critiques formulées par Justus von Liebig aux rendements élevés sur les terres cultivées obtenus grâce à l’extraction de nutriments sans la suffisante restitution de matière organique au biotope du sol.[28] On retrouve également cette idée dans les travaux d’autres scientifiques tels que Carl Fraas, qui dénonçait « l’économie du vol », consistant à produire des biens pour obtenir des profits à court terme tout en dégradant la base de ressources naturelles à long terme. Il étudiait également la notion de « communisme primitif » dans les travaux de l’anthropologue Lewis Henry Morgan et les communautés paysannes que les courants politiques du socialisme pro-paysan – «vert» ou narodnik – de toute l’Europe de l’Est et du Nord revendiquaient comme la base pour une transition directe vers une société non capitaliste qui éviterait les douleurs d’une industrialisation capitaliste.
Ces lectures, lettres et réflexions conduirent probablement le vieux Marx à repousser les limites de ses précédentes positions hégéliennes, partagées avec Engels, et à en reconsidérer certaines, comme le rôle des paysans et des communautés rurales. Un exemple frappant en est la ferme objection de Marx au premier point du Programme de Gotha de 1875 du Parti social-démocrate ouvrier allemand (SDAP), qui affirmait que « le travail est la source de toute richesse et de toute culture ». Marx répondit : « Le travail n’est pas la source de toute richesse. La nature est la source des valeurs d’usage (qui constituent véritablement la richesse matérielle !), ni plus ni moins que le travail, qui n’est que la manifestation d’une force naturelle, de la force de travail de l’homme ».[29]
Parmi les nombreux exemples de la pensée socio-écologique de Marx, il en est un qui est particulièrement pertinent et que Karl Kautsky tira de ses cahiers de 1863 sur les Théories de la plusvalue pour le publier dans le volume IV du Capital en 1905-1910 : « On peut anticiper et dévaster l’avenir en intensifiant l’effort jusqu’à l’épuisement, en rompant l’équilibre entre le flux qui est extrait et le flux qui est restitué. Les deux choses se produisent dans la production capitaliste, ou dans ce qui est considéré comme telle ».[30] Kohei Saito interprète cette formulation de Marx comme suit : « Le métabolisme entre les humains et la nature est un processus interactif et circulaire dans lequel les humains ne se contentent pas de prendre à la nature, mais lui donnent également en retour. La critique de Marx vise à montrer que la “valeur”, en tant que médiation du métabolisme, ne peut pas suffisamment prendre en compte cet aspect du retour ». Par « valeur », Kohei Saito fait ici référence aux valeurs monétaires issues d’une marchandisation qui exclut toute autre pluralité de valeurs, qu’elles soient énergétiques et matérielles, professionnelles, culturelles, spirituelles, politiques ou de toute autre nature.[31]
Indépendamment de la pertinence de la pensée socio-écologique de Marx pour notre compréhension actuelle du métabolisme social, il est certain qu’elle est restée un ensemble d’observations éparses auxquelles la plupart de ses disciples marxistes n’ont prêté aucune attention pendant un siècle. Le stalinisme y a sans doute largement contribué, comme le montrent les rares exceptions que constituent Rosa Luxemburg, Nikolaï Boukharine, Otto Neurath ou Christopher Caudwell dans le premier tiers du XXe siècle, puis Alfred Schmidt [32] et Manuel Sacristán. Un exemple révélateur de cet oubli est ce qui s’est passé lorsque l’Ukrainien Sergei Podolinsky, membre du mouvement politique « vert » pro-paysan ou narodnik, formé en physique et en médecine, a envoyé à Marx un essai dans lequel il transformait son idée du travail en tant que « force naturelle » en une analyse énergétique quantitative. Il y commençait à comptabiliser l’exploitation du travail et la plusvalue en unités caloriques, en se basant sur la thermodynamique développée par Sadi Carnot et Rudolf Clausius.[33] En 1982, Joan Martínez Alier et José Manuel Naredo firent connaître le malheureux désaccord d’Engels avec l’analyse énergétique de Podolinsky de 1880-1883, le présentant comme un événement crucial qui empêcha le développement d’un marxisme écologique pendant un siècle. [34]
Grâce aux extraits et aux notes de lecture de Marx (1880) dans la version française de l’essai de Sergei Podolinsky sur Le travail humain et la conservation de l’énergie (1880), récemment transcrits à partir de ses carnets et publiés par la Marx-Engels-Gesamtausgabe (MEGA), nous savons que Marx comprit parfaitement les idées de Podolinsky et s’abstint de les rejetter et d’y ajouter un quelconque commentaire critique. L’idée clé que Marx retenait de Podolinsky était que, en travaillant avec des plantes vivantes, des animaux domestiques, des sols fertiles et la force musculaire de leur corps, complétée par l’utilisation d’outils et de machines, les êtres humains sont capables d’augmenter, par leur travail et leurs connaissances, l’énergie utile dont ils disposent sur Terre. Comme l’ont souligné Martínez Alier et Naredo (1982), cette approche initiale aurait pu devenir un point de départ pour une analyse socio-métabolique du processus économique dans une perspective énergétique dès les années 1880.
Pour l’histoire de la pensée écologique et économique du métabolisme social, la question clé ici est que l’essai de Podolinsky sur l’énergie du travail humain anticipa dans une certaine mesure la notion que les flux biophysiques peuvent devenir « ectropiques » au sens défini plus tard par Felix Auerbach (1913), et reprise par Ilya Prigogine et Isabelle Stengers (1979) comme une propriété des structures énergétiquement dissipatives de la Terre; ou que le métabolisme des êtres vivants est « néguentropique » au sens le plus clair, mais aussi controversé, que lui a donné Erwin Schrödinger (1944); ou encore, comme dans la métaphore de Nicholas Georgescu-Roegen (1971), que les humains sont capables de « filtrer » la faible entropie dans le processus économique grâce à l’« indétermination » quantitative de la deuxième loi de la thermodynamique; ou dans les transformations « émergétiques » de l’énergie solaire tout au long des chaînes alimentaires analysées par Howard T. Odum (1971); ou dans la métaphore de Ramon Margalef (1993) selon laquelle les structures vivantes font circuler l’énergie en méandres, de sorte qu’elle peut s’accumuler temporairement à l’intérieur et qu’une partie de l’entropie peut être récupérée sous forme d’information dans leur complexité, comme s’il s’agissait d’un « compte d’épargne thermodynamique »; ou dans la notion d’« ascendance » proposée par Robert Ulanowicz (1986, 2009); ou dans l’idée de Mae-Wan Ho (2005) selon laquelle fermer les boucles de matière et d’énergie a un sens thermodynamique pour le maintien de la vie; ou dans la manière dont Morowitz (2002) explique « l’émergence de tout » à travers la complexité systémique. [35]
Même si Podolinsky l’exprimait de manière encore rudimentaire, en utilisant la métaphore d’une « machine parfaite de Sadi-Carnot » capable de réintroduire dans le processus de travail physique l’énergie dissipée sous forme de chaleur, l’essentiel réside dans le fait que son essai avait commencé à considérer le travail humain d’un point de vue énergétique. Même cette métaphore rudimentaire et inappropriée pouvait être interprétée comme ce que nous entendons aujourd’hui par la capacité reproductive des structures dissipatives vivantes. C’était l’avis du grand scientifique ukrainien Volodymyr Vernadsky, auteur du livre intitulé La Biosphère. [36] En 1924, il osa publier un autre livre sur la biochimie dans lequel il louait le travail de Podolinsky pour avoir souligné les différences thermodynamiques entre la matière vivante et la matière inerte, contribuant ainsi aux fondements d’une « énergétique de la vie ».[37] Il l’a fait quelques années avant qu’il ne devienne extrêmement dangereux de faire une telle chose dans une Union soviétique sous la Grande Terreur stalinienne déclenchée dans les années 1930, comme le prouve, entre autres, le procès et la mort de l’économiste russe Alexander Chayanov, également « vert » et favorable aux paysans.
En résumé, Podolinsky a proposé de réconcilier la théorie de la valeur-travail avec une analyse énergétique du processus économique sous l’angle du métabolisme social. Comme le souligne Cutler Cleveland, la raison la plus probable qui a conduit Engels à rejeter l’approche de Podolinsky était une conséquence très importante de son approche du stockage renouvelable de l’énergie solaire par des plantes en tant que producteurs primaires qui soutiennent presque toutes les transformations énergétiques dans l’ensemble du réseau de la vie de la biosphère. Cette analyse biophysique remettait en question l’expansion matérielle illimitée de la production humaine et impliquait également que les limites ultimes de la croissance économique ne résidaient pas dans les contraintes des rapports de production, mais dans les lois physiques et écologiques.[38]
Il est révélateur que, dans la lettre qu’Engels envoya à Marx pour rejeter cette tentative d’analyse énergétique du métabolisme social, l’une de ses principales critiques était la suivante : « Ce que Podolinsky a complètement oublié, c’est que l’homme, en tant que travailleur, n’est pas simplement un fixateur de la chaleur solaire actuelle, mais un gaspilleur bien plus important de la chaleur solaire du passé. Tu connais mieux que moi les réserves d’énergie, de charbon, de mines, de forêts, etc. que nous avons réussi à gaspiller ».[39] Engels avait sans doute raison de souligner ce point, mais il avait tort d’affirmer que Podolinsky avait omis les combustibles fossiles. Alf Hornborg (2004) a clarifié ce point en citant le paragraphe suivant de la version ukrainienne originale et plus longue de « Le travail humain et ses rapports avec la distribution de l’énergie », travail publié dans la revue Slovo en 1880, qui n’a pas été inclus dans les versions ultérieures récemment publiées et discréditées par John B. Foster et Paul Burkett [40]:
« Nous avons devant nous deux processus parallèles qui, ensemble, forment ce qu’on appelle le cycle de la vie. Les plantes ont la propriété d’accumuler l’énergie solaire, mais les animaux, en se nourrissant de substances végétales, transforment une partie de cette énergie stockée et la dissipent dans l’espace. Si la quantité d’énergie accumulée par les plantes est supérieure à celle dissipée par les animaux, des réserves d’énergie apparaissent, par exemple pendant la période de formation du charbon minéral, au cours de laquelle la vie végétale a prédominé sur la vie animale. Si, au contraire, la vie animale avait prédominé, l’approvisionnement en énergie se serait rapidement dissipé et la vie animale aurait dû revenir aux limites déterminées par la richesse végétale. Il faudrait donc établir un certain équilibre entre l’accumulation et la dissipation de l’énergie».
Comme l’a souligné Hornborg, Podolinsky n’a pas seulement insisté sur la différence entre l’utilisation du flux d’énergie solaire et le stock de réserves d’énergie du charbon. Il a affirmé que la productivité énergétique d’un mineur de charbon était bien supérieure à celle d’un agriculteur, mais que cet excédent énergétique du charbon n’était que temporaire. De plus, dans une note de bas de page, il ajoute l’existence d’« une théorie qui reliait les changements climatiques aux concentrations de dioxyde de carbone dans l’atmosphère, comme l’a expliqué Sterry Hunt lors d’une réunion de la British Society for the Advancement of Science en 1878 ». [41]
La question clé du rejet de Friedrich Engels se situait ailleurs : son refus total d’exprimer les relations économiques par des mesures physiques : «Podolinsky, partant de cette découverte très précieuse, s’est égaré parce qu’il a cherché dans la science de la nature une nouvelle preuve de la vérité du socialisme, et il a ainsi confondu l’économie avec la physique ».[42] Il est clair qu’Engels n’a pas compris l’importance d’une analyse quantitative du métabolisme social pour une évaluation non marchandisée du travail humain. En revanche, après la récente publication par la MEGA des notes de lecture écrites par Marx lui-même, nous savons désormais qu’il a très bien compris et résumé l’essai de Podolinsky, sans y ajouter aucune des critiques acerbes qu’il avait l’habitude d’inclure dans ses carnets lorsqu’il n’était pas d’accord avec les textes qu’il annotait. Marx n’a pas eu le temps de répondre à Podolinsky ni à la lettre d’Engels. Mais après avoir pris connaissance de son résumé des idées de Podolinsky, nous ne pouvons en aucun cas interpréter son silence comme un accord tacite avec le rejet d’Engels.
La triste histoire de ce malheureux malentendu entre Engels et Podolinsky laisse ouverte la question posée par Sacristán : si l’écologie était une tâche si centrale pour une société non capitaliste selon les brèves mais puissantes intuitions écologiques de Marx, pourquoi Engels a-t-il finalement répondu à Podolinsky par un refus catégorique ? Il est vrai qu’il partageait avec Marx la notion claire que le capitalisme dilapidait les combustibles fossiles. Cependant, outre le fait que l’idée qu’un tel gaspillage d’une source d’énergie non renouvelable pourrait être nuisible à l’environnement, elle mettrait également fin non seulement à la perspective d’une croissance capitaliste des forces productives, mais aussi à la croissance économique en tant que telle. Ceci dépassait la vision hégélienne de l’avenir d’Engels. Comme l’écrivait Manuel Sacristán un siècle plus tard, admettre cela aurait signifié non seulement pour Engels, mais aussi pour tout le mouvement ouvrier social-démocrate marxiste de l’époque, et pour le communisme qui lui succéda, abandonner le millénarisme utopique qui voyait dans la révolution sociale la fin de toutes les tensions et contradictions sociales dans un monde d’abondance.
Bien qu’ils aient soutenu l’analyse énergétique dans leur propre version du marxisme écologique, John Bellamy Foster et Paul Burkett tentent encore de discréditer les différentes versions de l’article publié par Podolinsky en les qualifiant d’incohérentes par rapport à ce qu’ils considèrent comme une analyse socio-écologique plus claire dans les écrits de Marx et Engels sur le sujet. Ils ont tort, tandis que Joan Martínez Alier et José Manuel Naredo ont vu juste en mettant le doigt sur le point faible de la tradition marxiste, à savoir son refus de procéder à une analyse énergétique du système économique. La seule nécrologie qui reste à rédiger est d’expliquer pourquoi, depuis la mort de Marx en 1883, tellement de marxistes ont ignoré non seulement la proposition de Podolinsky, mais même toutes ses tentatives écologiques, à quelques exceptions près. C’est une bonne occasion pour rappeler le mot de Marx à Paul Lafargue et que Manuel Sacristán aimait rappeler: «ce qui est certain, c’est que quant à moi, je ne suis pas marxiste ».[43]
À ce stade, il existe encore deux façons différentes de comprendre l’actualité du marxisme au XXIe siècle. Celle de ceux qui, sans tenir compte que Marx est un auteur du XIXe siècle qui a laissé une œuvre inachevée, s’obstinent à trouver dans ses textes la solution à tous les problèmes passés et à venir, pour ensuite se disputer entre eux afin de déterminer qui interprète le mieux le Maître. Et celle de ceux qui, au lieu de répéter ce que Marx a dit en tant que critique des économistes libéraux et des idées hégémoniques de son temps, comprennent que la tâche consiste à continuer à faire ce qu’il a fait alors : critiquer et proposer des alternatives aux idées hégémoniques et aux formulations économiques du capitalisme d’aujourd’hui qui menace de nous conduire à un effondrement civilisationnel mondial au XXIe siècle. S’il s’agit de fonder, à partir des meilleures connaissances scientifiques et pratiques, les aspirations partagées par de nombreuses personnes à une humanité juste sur une Terre habitable, l’insularité de la pensée qui caractérise le premier type de marxisme ne semble pas être le meilleur choix. Le second implique, au contraire, de s’ouvrir à un enrichissement mutuel avec de nombreuses autres traditions de lutte et de pensée alternatives au capitalisme sauvage de notre époque, en comprenant que nous devons tirer le meilleur de chacune d’entre elles pour un projet de transformation sociale pour lequel il existe un vaste plurivers de façons de le concevoir et de le nommer. [44] L’écosocialisme en est une, mais ce n’est qu’une parmi d’autres. Le marxisme peut continuer à apporter beaucoup à toutes ces traditions, mais seulement s’il reste ouvert à l’interaction avec les autres.
Probablement sur les conseils de Joan Martínez Alier et José Manuel Naredo, Manuel Sacristán a également lu et annoté l’essai de Podolinsky en 1978 ou 1979, et ses notes de lecture ont été récemment publiées. [45] Elles sont un peu plus détaillées que celles de Marx et expriment une appréciation claire de la tentative d’ouvrir l’étude de l’échange de la société avec le reste de la nature en termes énergétiques. Sacristán considérait même comme « une formulation très intéressante » la conception de l’être humain « comme la machine parfaite de Sadi-Carnot », que Foster et Burkett soulignent comme preuve de ce qu’ils considèrent à tort comme une mauvaise compréhension de la thermodynamique par Podolinsky. Sacristán ajoutait également quelques notes critiques intéressantes. Il soulignait à plusieurs reprises que la version de Podolinsky était écologiquement plus « optimiste » que celle du vieux Marx après ses lectures de Carl Fraas. Mais les deux critiques qui méritent d’être soulignées étaient que « l’agrégation de l’énergie est aussi imprécise sur le plan écologique que l’agrégation de la valeur », [46] et que la fin de l’essai lui semblait « très confuse […] sur le plan économique et social ». La première critique a été clairement admise et développée par l’économie écologique dans la proposition d’une analyse multicritères servant à la prise de décision dans le cadre de délibérations participatives, [47] et c’est Nicholas Georgescu-Roegen lui-même qui a été le premier à souligner la nécessité d’éviter le « dogme énergétique » en indiquant que « la matière compte aussi ». [48] En ce qui concerne la seconde, ce n’est que très récemment que l’analyse du métabolisme social a commencé à être utilisée pour mettre en évidence la formation des inégalités sociales et de genre, avec des résultats initiaux très prometteurs qui invitent à la développer davantage.[49]
Dans le cas de Sacristán, nous ne devons pas nous contenter de ses notes de lecture, ni interpréter son silence. Dans son article sur les « aperçus écologiques de Marx », il a inclus l’évaluation suivante, sans équivoque positive, de la proposition de Sergei Podolinsky :
« Le deuxième cas exceptionnel et brillant que je voudrais évoquer est celui de […] Sergei Podolinsky, qui a publié dans l’organe de la social-démocratie allemande un essai en deux parties très intéressant sur le concept marxiste de travail et la deuxième loi de la thermodynamique, le principe d’entropie. La loi de l’entropie dit que dans un système fermé, la quantité d’énergie utilisable, les différences de potentiel, pour ainsi dire, diminuent. La loi se réfère à un système fermé, et il est clair que la Terre ne l’est pas, car elle reçoit constamment de l’énergie du Soleil et en irradie; c’est pourquoi on a toujours discuté de la pertinence de la loi de l’entropie pour comprendre les processus humains sur Terre, en particulier les processus productifs. Mais la question n’est pas simple, car à l’objection selon laquelle la Terre est un système ouvert, on peut répondre que l’ensemble des sources de vie pour l’espèce humaine ne l’est peut-être pas. […]
Podolinsky a eu le grand mérite de rétablir le point de vue naturaliste que Marx avait expressément abandonné (pour se consacrer ensuite à l’économie politique) dans les premières pages de l’Idéologie allemande. Podolinsky le cultive à nouveau, en essayant de reconstruire l’idée de valeur-travail dans le cadre de la thermodynamique. Il est donc juste d’honorer la mémoire de Kautsky et Podolinsky à cet égard, mais après l’avoir fait, on peut répéter que les tentatives de pensée écologique-politique des classiques n’ont pratiquement pas eu de suite dans la tradition marxiste. Tout ce que nous appellerions aujourd’hui un problème politico-écologique était subsumé dans la tradition marxiste sous l’étiquette “maux du capitalisme”, sans voir la spécificité des risques d’un rapport civilisé avec la nature. C’est ainsi que s’est constituée une tradition progressiste sans problèmes, qui avait beaucoup plus à voir avec la tradition bourgeoise qu’avec une nouveauté socialiste.
Il faut se demander pourquoi cela s’est produit, mais il convient d’abord de s’intéresser à ce qui a été moins pris en compte dans les idées politico-écologiques de Marx. Il s’agit d’observations qui ne concernent pas l’écologie de la main-d’œuvre industrielle, mais l’agriculture».[50]
Comment Sacristán a-t-il pu amorcer un marxisme écologique dans les années 1970 à Barcelone ?
Pour répondre à cette question il faudrait un autre article consacré à expliquer en détail sa biographie intellectuelle et politique. Cependant, il convient de conclure en esquissant quelques remarques. Comme le dit John Bellamy Foster en parlant de la grande tragédie que subit le marxisme écologique après l’assassinat de Boukharine en 1938, le stalinisme devint un obstacle à la prise en compte de l’écologie politique encoré plus grand que le voile hégélien signalé par Sacristán.[51] Mais si l’hégélianisme avait été un obstacle à une exploration marxiste de ce que serait le socialisme, la tâche devait nécessairement être entreprise une fois que l’époque de la révolution se présenterait comme une possibilité non seulement actuelle- au sens historique et systémique – mais aussi immédiate.
Le fil rouge-vert rompu, issu des prémices écologiques de Marx, a été repris occasionnellement par des auteurs directement engagés dans les révolutions socialistes, tels que Rosa Luxemburg et Otto Neurath (lors de la révolution allemande de 1918-1919), Cristopher Caudwell (jusqu’à sa mort héroïque lors de la guerre civile espagnole en 1937) et Nikolai Boukharine (dans la révolution russe jusqu’au stalinisme). Toutes ces tentatives ont été écrasées sous le joug stalinien, une fois que la révolution soviétique s’est transformée en révolution industrielle et qu’après la collectivisation forcée et la Grande Terreur qui s’en est suivie, le «marxisme» officiel de l’URSS est devenu une idéologie d’État visant à légitimer la tâche de promouvoir une croissance économique planifiée de manière centralisée et promue par un régime tyrannique.[52]
Après les inhibitions causées d’abord par le brouillard dialectique hégélien, puis par la répression interne de la vulgate stalinienne, relancer une écologie politique marxiste comportait un nouveau départ. Une condition indispensable était d’adopter une position politiquement belliqueuse contre le stalinisme. Mais cela n’était pas suffisant, comme l’ont démontré de nombreux anti-staliniens qui ne se sont jamais intéressés à l’écologie politique au cours de la seconde moitié du XXe siècle. Pour dépasser la dialectique hégélienne, il fallait une reconsidération beaucoup plus libre et radicale des marxistes classiques.
Manuel Sacristán est devenu communiste alors qu’il avait déjà une solide formation en logique, en philosophie des sciences et en philosophie en général. Après avoir terminé son doctorat, en 1956, on lui offrit un poste au département de logique mathématique et de recherche fondamentale de l’université de Münster (Allemagne), qu’il refusa pour adhérer au Parti communiste espagnol et revenir à Barcelone afin de participer activement à la lutte clandestine contre la dictature franquiste.[53] Avec la communiste italienne Giulia Adinolfi, ils rejoignent la résistance antifasciste. Leur engagement politique n’avait rien à voir avec une adhésion aveugle à une idéologie abstraite. Il s’agissait avant tout d’un engagement lié à la communauté où ils vivaient et aux personnes à côté desquelles ils luttaient pour la liberté et pour un autre socialisme. À mon avis, cela explique pourquoi le marxisme de Sacristán a toujours été si libre. C’était exactement le type de marxisme libre-penseur dont on avait besoin pour se connecter à l’écologie politique dans le dernier quart du XXe siècle, reprenant ainsi la ligne rouge-verte rompue après la mort de Marx, que Rosa Luxemburg, Otto Neurath, Christopher Caudwell et Nikolai Boukharine avaient dû actualiser en période révolutionnaire.
Aujourd’hui, en particulier dans le Nord global, nous ne sommes peut-être pas vraiment proches d’une situation révolutionnaire immédiate. Cependant, la nécessité d’une telle révolution pour mettre fin à la fuite en avant aveugle vers un nouveau capitalisme sauvage déclenchée par le tournant néolibéral des années 1980 –juste au moment où commençait à être publié le périodique rouge-vert-violet Mientras tanto– n’avait rien perdu de son actualité. Au contraire, le projet de développer une humanité juste sur une Terre habitable se montrait plus nécessaire que jamais pour éviter un effondrement de la civilisation. Aujourd’hui, dans le cadre de la nouvelle science de la durabilité, nous appelons cela un environnement sûr et juste où chacun puisse mener une bonne vie à l’intérieur des limites de la planète.[54]
NOTES
1. Joan Martínez Alier, «La crisis energética y la agricultura moderna», Boletín de Información sobre Energía Nuclear, n° 11-13, juin 1980, p. 11-16.
2. Manuel Sacristán, «¿Por qué faltan economistas en el movimiento ecologista?», Boletín de Información sobre Energía Nuclear, n° 11-13, juin 1980, p. 63-67 (inclus dans Pacifismo, ecología y política alternativa, Barcelone, Icaria, 1987, p. 48-63).
3. Sacristán et Martínez Alier avaient exprimé publiquement leur désaccord à propos de la proposition d’Enrico Berlinguer d’une politique économique d’austérité face à la fin des « années dorées » de la croissance économique (1950-1973) due à la stagflation et à la première crise pétrolière. Manuel Sacristán comprit la justesse de la proposition de Berlinguer et souligna la possibilité d’en développer les implications environnementales. D’un point de vue libertaire, Joan Martínez Alier y voyait une simple répétition du corporatisme social-démocrate avec une forte accentuation keynésienne (Daniel Lacalle, Joan Martínez Alier et Manuel Sacristán, «Cinco cartas sobre eurocomunismo, marxismo y anarquismo», Materiales, n° 8, 1978, pp. 119-144).
4. Joan Martínez Alier avec Klaus Schlüpmann, Ecological Economics: Energy, Environment and Society, Oxford, Basil Blackwell, 1987.
5. Joan Martínez Alier et Klaus Schüpmann, La ecología y la economía, Mexico, Fondo de Cultura Económica, 1991, p. 318-319.
6. Martínez Alier publia de nombreux articles dans la première phase de Mientras tanto, lorsque Manuel Sacristán et Paco Fernández Buey faisaient partie de son comité de rédaction: «L’anàlisi energètica i la ciencia econòmica», vol. 12, 1982, pp. 47-57; «Réplica a mis críticos», vol. 23, 1985, pp. 37-43; «La base social del ecologismo de izquierda: ¿un neopopulismo ecológico?», vol. 25, 1985, pp. 21-28 ; «Utopismo ecológico: Popper-Lynkeus et Ballod-Atlanticus», vol. 33, 1987, pp. 71-85; (avec Antonio Flores Galindo) «Agriculture, alimentation et environnement au Pérou», vol. 34, pp. 79-89 ; «Le marxisme et l’économie écologique», vol. 35, 1988, pp. 127-147; nous en rendons compte dans Enric Tello et Manuel González de Molina, «Agrarian Metabolism and Socio-ecological Transition to Agroecology Landscapes», Sergio Villamayor-Tomas et Roldan Muradian (éd.), The Barcelona School of Ecological Economics and Political Ecology. A Companion in Honour of Joan Martinez-Alier, Springer Cham Open, 2023, pp. 93-107.
7. Manuel Sacristán, «Comunicación a las Jornadas de ecología y política de Murcia», Mientras tanto, n° 1, 1979, p. 19-24; reproduit dans Pacifismo, ecología y política alternativa, op. cit., p. 9-17 (la citation aux p. 12-14).
8. «Manuel Sacristán, o el potencial revolucionario de la ecología. Entrevista con Tele/Exprés (1979)», dans Francisco Fernández Buey et Salvador López Arnal (éd.), De la Primavera de Praga al marxismo ecologista. Entrevistas con Manuel Sacristán, La Catarata, Madrid, 2004, pp. 115-125 (citation en p. 122).
9. «Manuel Sacristán habla con Dialéctica. Dialéctica (1983)», dans De la Primavera de Praga al marxismo ecologista, op. cit., pp. 147-177 (citation en p. 152).
10. La préface a ensuite été publiée dans Manuel Sacristán, Intervenciones políticas. Panfletos y materiales, vol. III, Barcelone, Icaria, 1985, pp. 211-231 (citations tirées de la p. 227).
11. «Una conversación con Wolfgang Harich y Manuel Sacristán (1979)», Mientras tanto, num. 8, 1981, pp. 33-52 (citation à la p. 38). Manuel Sacristán traduisit en espagnol et publia en 1980 l’appel pacifiste antinucléaire d’Edward P. Thompson, «Protesta y Sobrevive», Mientras tanto, num. 5, pp. 33-54, et num. 6, pp. 85-106. E. P. Thompson rendit visite à Sacristán pour l’inviter à participer au débat européen Est-Ouest avec la Charte 77, issue en Tchécoslovaquie, et publia son article «Changing the Nature of Politics» dans le Journal of European Nuclear Disarmament, num. 19, 1986, pp. 21-22 (premier texte de Manuel Sacristán publié en anglais).
12. Manuel Sacristán, Intervenciones políticas…, op. cit., p. 221.
13. Dans le vol. 9, 1978, pp. 5-16.
14. Salvador López Arnal considère que le débat de Sacristán de 1979 avec Wolfgang Harich ne représenta pas un moment initial où les questions écologiques aient pris une importance capitale dans sa pensée, car il existait déjà des prémices remontant à 1972; voir Salvador López Arnal et Pere de la Fuente (éd.), Acerca de Manuel Sacristán Luzón, Barcelone, Destino, 1996, p. 131. Les meilleures biographies succinctes de Manuel Sacristán sont l’introduction de Francisco Fernández Buey et Salvador López Arnal au livre De la primavera de Praga al marxismo ecologista, op. cit., p. 9-31 ; et celle de Joaquim Sempere, «Manuel Sacristán : una semblanza personal, intelectual y política», publiée dans Mientras tanto, vol. 30-31, 1987, pp. 5-31, révisée et mise à jour dans le numéro 242, février 2025 (https://mientrastanto.org/242/ensayo/manuel-sacristan-una-semblanza-personal-intelectual-y-politica/). Il convient également de lire Juan-Ramon Capella, La práctica de Manuel Sacristán. Una biografía política, Madrid, Trotta, 2005; et, en anglais, celle de Renzo Llorente (éd.) dans The Marxism of Manuel Sacristán. From Communism to the New Social Movements, Brill, Leiden-Boston, 2014, pp. 1-22.
15. Manuel Sacristán traduisit et édita le livre de Samuel M. Barrett (éd.), Gerónimo. Historia de su vida, Barcelone, Grijalbo, 1975. Juan-Ramón Capella témoigne son amour pour la randonnée, ainsi que son intérêt pour la biographie de Gerónimo (La práctica de Manuel Sacristán, op. cit., pp. 177-183).
16. Reproduit dans La práctica de Manuel Sacristán, op. cit., p. 179. Dans le même ordre d’idées, Giulia Adinolfi fit valoir que le travail domestique était supérieur au travail marchand, dans son «Esquema sobre el trabajo doméstico», Mientras tanto, vol. 3, 1980, pp. 19-21.
17. De la Primavera de Praga al marxismo ecologista, op. cit., pp. 160-162.
18. Karl Marx, El Capital. Crítica de la economía política, Libro I. El proceso de producción del capital, Capítulo XIII, Sección IV: La producción de la plusvalía relativa, OME 41, Barcelone, Grijalbo, 1976, p. 141-142 (traduction espagnole de Manuel Sacristán).
19. Marina Fisher-Kowalski, M., «Society’s metabolism: The intellectual history of materials flow analysis, part I, 1860-1970», Journal of Industrial Ecology, vol. 2(1), 1998, pp. 61-77; Marina Fisher-Kowalski et Walter Hüttler, «Society’s metabolism: The intellectual history of materials flow analysis, part II, 1970-1998», Journal of Industrial Ecology, vol. 2(4), 1998, pp. 107-136.
20. «Algunos atisbos político-ecológicos de Marx», reproduit dans Pacifismo, ecología y política alternativa, op. cit., pp. 139-150 (citation aux pp. 146-147).
21. Ibid., p. 147.
22. Manuel Sacristán Luzón, «La tarea de Engels en el Anti-Dühring», préface à F. Engels, Anti-Dühring. La subversión de la ciencia por Eugen Dühring, Mexico, Grijalbo, 1968, pp. VII-XXVII (citation aux pp. XV-XVII).
23. Otto Neurath, Fundamentos de las ciencias sociales, Madrid, Taller Ediciones Josefina Betancor, 1973; et Economic Writings. Selections 1904-1945 (éd. de Thomas E. Uebel et Robert S. Cohen), Dordrecht, Academic Publishers, 2004.
24. Yuya Kajikawa, «Research core and framework of sustainability science», Sustainability Science, vol. 3, 2008, pp. 215-239; Giuseppe Munda, «Multiple Criteria Decision Analysis and Sustainable Development», dans Salvatore Greco, Matthias Ehrgott et José Figueira (éd.), Multiple Criteria Decision Analysis, New York, Springer, 2016, pp. 953-988. Disponible en libre accès à l’adresse: https://download.e-bookshelf.de/download/0000/0002/62/L-G-0000000262-0002368181.pdf
25. Ibid., pp. 147-150. Dans l’interview précitée de 1979, Sacristán avait déjà déclaré : « Ce n’est pas une boutade: il faut récupérer les idées révolutionnaires. De la même manière qu’il faut oublier le Hegel de la “négation de la négation” ou l’idée qu’il faut empirer au maximum pour qu’ensuite la situation s’améliore » (De la primavera de Praga al marxismo ecologista, op. cit., p. 121).
26. Dans Pacifismo, ecología y política alternativa, op. cit., pp. 9-17 (citation aux pp. 9-10 et 3).
27. Dans Pacifismo, ecología y política alternativa, op. cit., pp. 37-40 (citation à la p. 39).
28. Justus von Liebig, «On English Farming and Sewers», article publié dans le journal londonien Times en 1859, et reproduit dans la Monthly Review, vol. 70(3), en 2018. Disponible en libre accès: https://monthlyreview.org/2018/07/01/on-english-farming-and-sewers/
29. Marx, K. (1875), Critique du programme de Gotha. Première partie, disponible en libre accès en espagnol: https://www.marxists.org/espanol/m-e/1870s/gotha/critica-al-programa-de-gotha.htm
30. Je remercie Manuel Monleón pour la traduction de ce texte allemand de Marx : « Antizipation der Zukunft –wirkliche Antizipation- findet überhaupt in der Produktion des Reichtums nur statt mit Bezug auf den Arbeiter und die Erde. Beibeiden kann durch vorzeitige Überanstrengung und Erschöpfung, durch Störung des Gleichgewichts zwischen Ausgabe und Einnahme, die Zukunft realiter antizipiert und verwüstetwerden. Beibeiden geschieht es in der kapitalistischen Produktion. Was die sog » […]. Karl Marx, (1968[1863]), Theorien des Mehrwerts. In : Karl Marx und Friedrich Engels Werke, volume 26 [Troisième partie], Berlin, DietzVerlag, p. 303). L’édition MEGA traduit cet équilibre entre « Ausgabe » (entrée) et « Einnahme » (sortie) par « un équilibre entre les dépenses et les recettes ». Cependant, il ressort clairement du contexte que Marx ne faisait pas référence à un équilibre monétaire, mais à un équilibre biophysique, conformément au commentaire de Koehi Saito.
31. Koehi Saito, La naturaleza contra el capital. El ecosocialismo de Karl Marx, Barcelone, Edicions Bellaterra, 2022, pp. 176 et 182-183; voir également Joan Martinez-Alier, «Social Metabolism, Ecological Distribution Conflicts, and Languages of Valuation», Capitalism Nature Socialism, vol. 20(1), 2009, pp. 58-87.
32 Schmidt, A. (2014[1962]), The Concept of Nature in Marx, Londres, Verso. Disponible sur: http://pinguet.free.fr/schmidt1962.pdf
33. Sergei Podolinsky, «El trabajo del ser humano y su relación con la distribución de la energía», dans Joan Martínez Alier (éd.), Los principios de la economía ecológica. Textos de P. Geddes, S. A. Podolinsky y F. Soddy, Madrid, Fundación Argentaria-Visor, 1995, pp. 63-142. Disponible en libre accès à l’adresse: http://elrincondenaredo.org/wp-content/uploads/2024/12/I-los-principios-de-la-economia-ecologica-1.pdf
34. Joan Martínez Alier et José Manuel Naredo, «A Marxist Precursor of Energy Economics: Podolinsky». The Journal of Peasant Studies, vol. 9(2), 1982, pp. 207-224.
35. Felix Auerbach, Die Welt herrin und ihr Schatten: Ein Vortrag über Energie und Entropie. 2. ergänzte und durchgesehene Aufl., Iéna, Fischer, 1913 ; Illya Prigogine et Isabelle Stengers, La Nueva Alianza: Metamorfosis de la Ciencia, Madrid, Alianza Editorial, 1997; Erwin Schrödinger, ¿Qué es la vida?, Barcelone, Tusquets, 2015[1944]; Howard T. Odum, Ambiente, energía y sociedad, Barcelone, Blume, 1980 ; Ramon Margalef, Teoría de los sistemas ecológicos, Barcelone, Publications de l’Université de Barcelone, 1993 (2e éd.); Robert E. Ulanowicz, «Some steps toward a central theory of ecosystem dynamics», Computational Biology and Chemistry, vol. 27(6), 2003, pp. 523-530; Mae-Wan Ho et Robert E. Ulanowicz, «Sustainable systems as organisms?», BioSystems, vol. 82, 2005, pp. 39-51; Mae-Wan Ho, «Circular Thermodynamics of Organisms and Sustainable Systems», Systems, vol. 1, 2013, pp. 30-49; Harold J. Morowitz, The Emergence of Everything: How the World Becomes Complex, Oxford, Oxford University Press, 2002.
36. Vladimir I. Vernadsky, La Biosfera (introduction de Ramon Margalef), Madrid, Fundación Argentaria-Visor, 1997[1926]. Disponible en libre accès: https://elrincondenaredo.org/wp-content/uploads/2024/12/IX-La-biosfera-final.pdf.
37. Vladimir I. Vernadsky, Geochemistry and the Biosphere, Santa Fe, Synergetic Press, 2007[1924], p. 212.
38. Cutler J. Cleveland, «Biophysical Economics: From Physiocracy to Ecological Economics and Industrial Ecology», dans John M. Gowdy et Kozo Mayumi (éd.), Bioeconomics and Sustainability: Essays in Honor of Nicholas Georgescu-Roegen, Cheltenham, Edward Elgar, 1999, pp. 125-154.
39. Friedrich Engels, lettre à Karl Marx du 19-12-1882 [Marx est mort le 14-03-1883]. Disponible en espagnol en libre accès: https://www.marxists.org/espanol/m-e/cartas/e1882-12-19.htm
40. John B. Foster et Paul Burkett, «The Podolinsky Myth: An Obituary. Introduction to “Human Labour and Unity of Force” by Sergei Podolinsky», Historical Materialism, vol. 16, 2008, pp. 115-161; et Sergei Podolinsky, «Human Labour and Unity of Force», Historical Materialism, vol. 16(1), 2008 [1880-1883], pp. 163-183.
41. Alf Hornborg, Marxism, social metabolism, and ecologically unequal exchange, document de travail de l’Unité d’Histoire économique de l’Université Autonome de Barcelone n° 21/2004–UHE/UAB. Disponible en libre accès: https://ddd.uab.cat/pub/estudis/2004/hdl_2072_1194/UHE21-2004.pdf
42. Friedrich Engels, lettre à Karl Marx du 19-12-1882, op. cit.
43 Friedrich Engels, lettre à Eduard Bernstein du 02-11-1882. Disponible en libre accès: https://www.marxists.org/francais/engels/works/1882/11/fe18821102.htm.
44. Ashish Kothari, Ariel Salleh, Arturo Escobar, Federico DeMaria et Alberto Acosta, Pluriverso. Un diccionario del posdesarrollo, Barcelone, Icaria, 2019.
45. Manuel Sacristán Luzón, Filosofía y metodología de las ciencias sociales (II), édition de Salvador López Arnal et José Sarrión Andaluz, Barcelone, 2024, pp. 197-202.
46. Ibid., p. 202.
47. Giuseppe Munda, Social Multi-Criteria Evaluation for a Sustainable Economy, New York, Springer, 2008.
48 Nicholas Georgescu-Roegen, «Energy Analysis and Economic Valuation», Southern Economic Journal, vol. 45(4), pp. 1023-1058.
49. Inés Marco, Roc Padró et Enric Tello, «Labour, nature, and exploitation: Social metabolism and inequality in a farming community in mid-19th century Catalonia», Journal of Agrarian Change, vol. 20,2020, pp. 408-436; et «Dialogues on nature, class and gender: Revisiting socio-ecological reproduction in past organic advanced agriculture (Sentmenat, Catalonia, 1850)», Ecological Economics, vol. 169, 2020, 106395.
50. «Algunos atisbos…», dans Pacifismo, ecología y política alternativa, op. cit., pp. 144-145. Sacristán a écrit à tort que Podolinsky était polonais, alors qu’il était ukrainien. Dans cet article, j’utilise la translittération plus courante du nom russe de cet auteur (Sergei Podolinsky), et non celle – moins connue – revendiquée récemment en Ukraine, son pays (Serhii Podolynsky). Voir: https://commons.com.ua/en/zhoan-martines-alyer-podolinskij-viperediv-svij-chas/
51. John B. Foster, «Epílogo» à La ecología de Marx: materialismo y naturaleza, Barcelone, El Viejo Topo, 2004, pp. 363-367.
52. Manuel Sacristán Luzón, «Sobre el estalinismo», conférence de 1978 publiée dans Mientras tanto, vol. 40, pp. 147-158 (et reproduite dans Salvador López Arnal, Seis conferencias sobre la tradición marxista y los nuevos problemas, Barcelone, El Viejo Topo, 2005. pp. 27-54). Dans le même numéro de Mientras tanto, j’ai publié «El socialismo irreal. Bosquejo histórico de un sistema que se desmorona», pp. 91-128.
53. Voir les textes biographiques cités dans la note 14.
54. Jason Hickel, Menos es más. Cómo el decrecimiento salvará al mundo, Madrid, Capitán Swing, 2023.


